

La clepsydre marquait la troisième heure de la nuit, quand le sultan Schariar entr'ouvrit les yeux, étendit les bras et se prit à bâiller, à bouche ouverte et à poings fermés.
— Ma soeur, — s'écria l'insupportable Dinazarde, — le sultan bâille, donc il est éveillé, comme dirait Descartes, alors, vous plairait-il nous conter encore quelqu'un de ces contes que vous contez si bien ?...
— Soit, ma soeur, — répondit la douce Shéhérazade, toujours sans défense alors qu'il s'agissait de faire un récit, — si le commandeur des croyants y consent, je vous dirai cette fois le conte de Togrul, le « Videur de Poêtes » ?
« Le commandeur des croyants », on l'appelait encore ainsi, bien que le scepticisme eût déjà pénétré fortement l'empire, fit de sa tète auguste, un signe d'acquiescement ennuyé, puis il s'accota, dans sa résignation coutumière, à des carreaux de drap d'or, envoyant dans les airs quelques spirales de fumée bleue.Par la force de l'habitude, Dinazarde lui avait apporté son narghilé bourré de plantes aromatiques.
Par la force de l'habitude, le sultan s'était mis à fumer.
Et par la force de l'habitude, Shéhérazade entamait son récit.
Il y avait trente ans que cela se passait ainsi, chaque nuit.
La vieillesse était venue, personne ne l'avait senti venir.
Le sultan entrait dans sa soixante-dixième année; la patte d'oie plissait ses tempes ; les poches de ses yeux ternes se gonflaient de toutes les larmes économisées pendant la vie ; son crâne chauve et lisse avait pris le luisant mat de l'ivoire; et la grande barbe blanche qui ondulait sur sa poitrine, descendant jusqu'au nombril, lui donnait l'aspect d'un fleuve.
Cependant que la sultane Shéhérazade, l'aînée des deux soeurs s'éloignait déjà de la soixantaine, du mauvais côté, et que Dinazarde, la cadette, s'en approchait à bien petite distance.
Ayant légèrement toussé, de cette aigrelette toux nerveuse qui commande l'attention, Shéhérazade s'exprima en ces termes :


— Sire, jadis, en Perse, dans la ville de Meschid, vivaient deux frères d'une éclatante beauté. Ils s'aimaient tendrement. Tous deux étaient poètes. La Poésie, à cette époque, était florissante en cette contrée, qu'embaume le souvenir du grand Saadi.L'aîné des deux frères, Mohammed, était doux comme une femme, malgré ses larges épaules, son oeil brun, qui lançait des éclairs, sa barbe épaisse dont les cannelures d'ébène descendaient sur sa robe brodée d'or. Il ciselait, de main d'ouvrier, les rythmes de la Poésie légère, et en possédait si bien la cadence, que lorsqu'il lisait ses poèmes, l'oreille percevait quelque douce mélopée de luths et de tambourins.
Cassib, le cadet, imberbe, avait, tout au contraire, un corps d'éphèbe, et son visage, de pâleur mate, transparent comme le miel, s'éclairait d'yeux bleus, aux regards de gazelle ; mais sous cette apparence efféminée, il cachait une énergie sans seconde, un coeur plein de vaillance ; et, lui, composait, dans un verbe vengeur, la poésie satirique, qui cinglait jusqu'au sang.
Tant il est vrai que la, nature se plaît aux contrastes !
Mohammed et Cassib habitaient, un magnifique Palais, au milieu d'un jardin fleuri de roses, et les pilastres finement sculptés de la cour intérieure se miraient en un bassin où des eaux jaillissantes répandaient une reposante fraîcheur.
Là, leurs journées s'écoulaient douces et unies, dans une monotonie charmante, soit à composer des poèmes, soit à écouter, rêveurs, des musiques pincées en sourdine, soit à se livrer à la fraîcheur du bain, dans la piscine de marbre vert. Et comme jamais une femme n'avait pénétré dans leur retraite, leur fraternelle amitié était demeurée forte et sans nuage.
Un jour, à la venue du crépuscule, Cassib, qui n'avait pas vu son frère depuis le matin, inquiet, frappa d'une baguette de métal, sur un plat d'airain suspendu dans les airs, par une double cordelette de soie rouge, Ali, l'esclave noir, au buste luisant, apparut aussitôt et se prosterna, attendant les ordres.
— Préviens Mohammed, ton maître, lui dit Cassib, que le soleil descend vers la mer, et que l'heure du souper est venue.
— Seigneur, répondit Ali, en s'inclinant plus bas encore, votre frère n'est pas ici et nul ne l'a vu depuis hier... Cassib effrayé, envoya ses gens à la recherche de Mohammed, à travers la ville de Meschid. Ce fut en vain. La nuit se passa en recherches inutiles, et quand l'aurore vint dorer le ciel, tous rentrèrent harassés, tête basse, mine confuse, mais sans nouvelles de Mohammed.
Cassib, tout en larmes, alla trouver le vieux Atabec-Zenguy, qui les avait élevés tous deux, après la mort de leurs parents, et lui conta ses inquiétudes. Atabec-Zenguy, qui avait la sagesse d'un centenaire, secoua tristement sa tète blanche, où germait un jugement sûr :— Il faut, voir là, Cassib, dit-il gravement, une autre cause que la main des hommes. Ce sont les génies, n'en doute point, qui t'ont ravi ton frère. Et voici mes raisons de le croire; les relations de mon négoce me font parvenir des nouvelles de toute la Perse, voire de la grande Tartarie et de l'Égypte. Or, j'ai appris par des marchands, que dans toutes les villes de Perse, à Armol, à Sâri, à Kirmanchach, à Cbeheinston, les poètes disparaissaient mystérieusement, sans que jamais on ait pu connaître ce qu'ils étaient devenus : le dernier poème de ton frère, sur le Nobeghdjana, qui n'a pas encore été gravé sur la cire, mais que tu sais par cœur, et dont il m'a déclamé des fragments, l'auraient fait l'égal des plus illustres. Les génies auront été jaloux de cette inspiration divine. Ils ont enlevé ton frère, cela est certain, pleure-le donc, de toutes tes larmes, car vraiment, plus jamais ne le reverras ! !
Cassib passa trois jours et trois nuits dans la douleur, vêtu de deuil, et la tète couverte de cendres. Puis, il retrouva courage, se frappa sept fois la poitrine, de son poing fermé, et prit son bâton de voyage, jurant par Ahriman, le maudit, qu'il ne rentrerait au logis, que tenant son frère bien-aimé par la main droite.
Puis il marcha sans repos, pendant plus d'un mois, escaladant les montagnes, traversant les plaines, les forêts, les rivières, sans trouver aucun indice qui le mît sur les traces de Mohammed.
Un jour, accablé de fatigue, mourant de faim, les pieds brûlés d'ampoules, il s'assit au bord d'un lac, pour chercher un peu de fraîcheur et de repos, avant de reprendre sa marche. Là, il s'abandonna encore au désespoir. Ses sanglots retentirent et ses larmes, en tombant, ridèrent l'eau limpide.
Cependant, une bourrasque étant venue à souffler, comme il arrive parfois, les eaux se gonflèrent et formèrent des vagues. Celles-ci, ruisselantes d'écume, sautèrent les unes par-dessus les autres, faisant déborder la nappe, qui s'allongea à l'infini sur les bords, puis brusquement se retira, avec un murmure confus, abandonnant, comme épaves, quelques coquillages et quelques fleurs.
En promenant ses regards autour de lui, Cassib aperçut couché, sur le sable, à sec, et respirant à peine, un poisson aux écailles bleues, que le flot avait déposé au rivage. Le malheureux étouffait, hors de son élément ; ses flancs battaient d'angoisse, et il semblait, de son oeil d'or, implorer la pitié. Cassib était bon musulman : il avait le respect delà vie. Il saisit donc le poisson bleu, avec précaution et, doucement, le remit dans le lac. A peine le poisson eut-il battu l'onde, de sa queue frétillante, qu'une trombe d'eau s'éleva en spirale, avec une vitesse vertigineuse, puis, s'étant abaissée brusquement, laissa voir un Génie de haute taille, aux ailes rosées, qui parla ainsi :— Tu m'as sauvé, Cassib, car j'étais prisonnier, enfermé dans le corps d'une dorade, par l'enchantement de mon ennemi, le génie Dauhasch, et je ne devais retrouver ma forme que le jour où un être humain pris de pitié, m'aurait rejeté à l'eau. J'allais mourir ; je te dois la vie, et veux te prouver ma reconnaissance. Je sais ce que tu cherches ; je connais la prison où gémit ton frère. Je t'y conduirai donc. Mais là s'arrêtera ma puissance. Ensuite, de toi seul, de ton courage et de ton habileté, dépendra la réussite de l'entreprise.

Ayant dit ces mots, il tira quatre cris aigus d'un sifflet d'émeraude pendu à sa ceinture, et l'air s'obscurcit soudain par les battements des ailes immenses de quatre rockes géants, qui vinrent s'abattre des quatre coins du ciel.
— Étends ton manteau par terre, et t'assieds dessus, auprès de moi ! dit le Génie à Cassib.
Et celui-ci ayant obéi, les quatre rockes prirent chacun un coin du manteau, dans leur bec recourbé, et s'enlevèrent au plus haut des airs.
Quelques instants après, ils déposèrent les voyageurs au pied d'une montagne, et sur un signe du génie, disparurent dans l'horizon.

— C'est en haut de cette montagne qu'est ton frère, dit le Génie, c'est là qu'il faut aller le chercher. Va donc ! et bon courage, car tu auras mille difficultés à vaincre, et à toi seul, car, ainsi que je te l'ai dit, il ne m'est pas permis de t'accompagner plus loin. Voici cependant une amulette précieuse qui t'aidera à triompher des embûches qui vont, se dresser sur ton chemin ; c'est un talisman rare, que cette amulette faite avec la peau cousue des paupières de femmes fidèles. Tu éprouveras son pouvoir, si tu la touches, en disant : « Allah me garde ! » mais une fois au sommet de la montagne, son pouvoir ne te sera plus de rien... Ah ! encore une recommandation importante ; ne dis pas que tu es poète, ne le dis pas, et ne le laisse pas deviner...
— Pourquoi ? fit Cassib, étonné.
— Je ne puis répondre à ta question, mais tu connaîtras, par la suite, que ce n'est pas un vain conseil que je te donne. Tu te présenteras donc comme un colporteur égaré, venu dans le pays, par hasard...
Cassib mit dix jours pour faire sa route, et il lui fallut, successivement lutter contre des crapauds volants, des serpents énormes, qui se dressant droits sur leurs queues, semblaient des arbres séculaires dépouillés de leurs branches, des armées entières de nains hauts de six pouces montèrent à l'assaut de son corps et lui tirèrent les cheveux, lui grattant les narines, lui soufflant dans les oreilles et lui crachant dans les yeux. Puis, il traversa des endroits semblables à des sables mouvants, où, à chaque pas, son corps enfonçait jusqu'à la ceinture ; passa par d'autres lieux arides, sans végétation où la terre était, crevassée de chaleur, et. où des flammes aiguës et des fumées méphitiques sortaient de ces crevasses et lui roussissaient les cheveux ; il escalada des rochers à pics, couverts de neige et de verglas, où à peine descendu de l'un par une glissade, il fallait franchir l'autre en s'ensanglantant les mains et les pieds. Mais partout son amulette lui fit surmonter les dangers.Parvenu enfin au sommet de la montagne, Cassib aperçut un parc verdoyant, avec des pelouses immenses. Pour y pénétrer, il fallait traverser des taillis épais. Ceci n'étant pas pour le gêner, il s'approcha, et voulut passer outre. Aussitôt, les branches lui cinglèrent le visage et des voix mystérieuses se prirent à l'invectiver dans toutes les langues humaines ; mais il toucha son
amulette, en prononçant les paroles magiques : « Allah me garde ! » et, sitôt, les branches s'écartèrent, et, s'étant dressées, puis recourbées, formèrent une voûte épaisse au-dessus de sa tète.Il se trouva alors dans un jardin enchanteur éclatant, de fleurs odorantes, autour desquelles bourdonnait, un essaim de mouches au corselet d'acier, et aux yeux de diamant. C'était, de tous côtés, des buissons de roses de toutes couleurs ; des jasmins des Indes, formant autour des arbres une cuirasse de feuillage vert sombre étoilé d'or ; des corylopsis aux fleurettes grelottantes ; des digitales pourpres, de plusieurs coudées de hauteur, dont les clochettes sonnaient en cadence, au souffle du vent ; des soleils immenses, au cœur de jais scintillant, dont les pétales jaunes, formant couronne, reflétaient les rayons de l'astre de lumière, qu'elles renvoyaient en étincelles. Une longue avenue sablée d'or et bordée d'orangers, en boules, chargés à la fois de fleurs odorantes et de milliers détruits orgueilleux, conduisait au château qui était de marbre incrusté de plaques d'acier.
Il aperçut alors des personnages étranges, qui étaient comme les gardiens du château; êtres singuliers, faits comme des hommes, mais ayant deux fois la hauteur d'un être humain, et dont le corps, au lieu d'avoir le modelé et l'épaisseur, était mince comme une baguette. A l'extrémité, par contre, ce qui représentait la tête était une boule énorme quatre fois grosse comme une tête humaine, ayant seulement des cheveux en touffe rouge au sommet du crâne et quatre yeux, ce qui leur permettait de voir de tous côtés.Dès qu'ils l'aperçurent, deux de ces personnages s'avancèrent contre lui. Il répéta alors sa leçon :
— Je suis un pauvre marchand de Mossoul égaré qui vous demande l'autorisation de se reposer un instant.
Sans l'écouter, l'un des monstres ayant enroulé son mince corps en spirale, se prépara à lui lancer sa formidable tête dans l'estomac, imitant un peu ces anciennes machines nommées catapultes.
Cassib se jeta rapidement, de côté, et le monstre, lancé à toute volée, disparut dans l'espace, sans toucher sa victime.
— Ah ! ah ! — dit Schariar, qui était volontiers de pédante humeur, et aimait à faire montre d'érudition. — Je sais ce que c'est que ce coup de tête dans l'estomac. Il est terrible, et on n'y résiste guère. Pline l'Ancien le connaissait déjà, il l'appelait Ictus Patris Francisci, ce que nous traduisons familièrement par «le coup du père François».
Un autre monstre, replié sur lui-même, s'apprêtait, à son tour, à frapper Cassib, de sa tète redoutable, et, de tous côtés, les autres se préparaient, menaçants, lorsqu'une voix de femme, d'un timbre charmant, s'écria, impérative :
— Arrière, chiens, disparaissez, fuyez ma présence.
Et les monstres, s'inclinant, disparurent aussitôt.
Cassib s'étant alors retourné, aperçut une dame de taille élégante, et dont un voile couvrant la figure ne laissait apercevoir que les yeux.
— Qui es-tu ? dit-elle, et comment as-tu pu pénétrer jusqu'ici ?
Se souvenant à propos de son rôle, il répondit :
— Je suis un marchand de Mossoul égaré dans ce pays.
Et, malicieusement, il fît étalage des étoffes précieuses, qu'il déploya sous les yeux de la dame, qui soudain s'éclairèrent de convoitise. Séduite, elle voulut essayer le charme des tissus, sur elle-même ; elle défit son voile, et Cassib eut devant lui, une merveille de beauté. Il se sentit tout ému en voyant ces yeux de saphir limpide, ces narines palpitantes, comme deux pétales de rose, où se jouerait la brise, cette bouche divine dont l'arc était humide et rouge, comme le corail, quand on vient de le cueillir dans la mer, et les dents blanches, fines et égales, comme des grains de riz.
Cassib éprouva alors un sentiment singulier qu'il ne connaissait pas encore, et tout son être frémit de tendresse, alors que la dame, fascinée par la grâce juvénile du feint marchand — ai-je dit que Cassib était beau comme un jeune dieu ? — laissait percer dans ses regards les sentiments de son cœur.— Suis-moi, dit-elle, viens dans mon palais, tandis que le « vieux de la Montagne » n'y est pas ; je veux choisir ce qui peut me plaire dans tes marchandises, puis, pauvre enfant, te remettre sur ta route, et te sauver du danger de mort qui te menace.

Cassib suivit la dame dans ses appartements, qui étaient de richesse inouïe, et dont les portes s'ouvrirent, toutes seules, devant elle.
Alors, encouragé par son accueil, il osa l'interroger.
— Pourquoi, dit-il, reine de beauté, choisir toutes ces étoffes, si c'est afin de t'en parer simplement pour les murailles de métal de cette forteresse. C'est dans les regards des hommes qu'on peut juger si l'on est belle : pourquoi ne pas descendre de cette montagne, pour aller te faire admirer dans les villes de la plaine ?
Ah! — répondit-elle avec un soupir, — ce n'est pas de mon propre gré, que je suis ici, et il ne dépend pas de moi non plus d'en sortir.
— Serait-ce donc ton père qui te tient cruellement prisonnière ?
— Mon père, hélas, doit pleurer les larmes de ses yeux, car il m'aimait plus que tout au monde et il doit me croire morte puisque j'ai disparu à tout jamais.
— Ne peux-tu me conter par quelle suite d'aventures tu es ici ?
— Très volontiers, d'autant que tu es le premier être humain que je vois depuis bien des années et que j'éprouve pour toi, une sympathie singulière, et une confiance sans bornes.
Cassib prit les mains de la dame qu'il porta amoureusement à ses lèvres.
Elle le laissa faire, puis elle reprit :
— Je m'appelle Zobéide, et suis fille du sultan d'Egypte. Je vivais à la cour de mon père, très heureuse, entourée des joies de l'existence, et plusieurs princes avaient déjà sollicité l'honneur de ma main, lorsqu'arriva dans notre pays un vieillard à barbe blanche, qui, ayant demandé audience à mon père, lui dit : « Je suis le prince des poètes de la Perse, et à ce titre, je vaux tous les princes de la terre... Je viens donc te demander ta fille en mariage. » Mon père lui rit au nez, et ordonna à son grand vizir de faire administrer cinquante coups de bâton, sur la plante des pieds, à ce vieux barbon, pour le punir de son insolence. Mais deux jours après, je tombai dans un profond sommeil provoqué probablement par un narcotique, et quand je me réveillai, je me trouvais dans cette forteresse inexpugnable, auprès de Togrul, dont le surnom plus connu de « vieux de la Montagne » suffit à faire trembler les hommes à vingt stades à la ronde.
— Comment ? — interrompit Cassib, — je suis ici chez Togrul, le roi des poètes, la gloire de la Perse, le maître en tous genres, celui qui nous domine tous, et dont la fécondité tient du prodige, Togrul, qui...
— Oui, tu es chez Togrul, le grand poète... pour le mal qu'elle lui donne, sa poésie !... — répliqua Zobéide, non sans amertume, — Togrul, le grand poète, ou plutôt, Togrul, le magicien infâme, Togrul, le « Videur de Poètes », chez lequel on ne parvient pas sans dire adieu à la vie, car, s'il était ici, pauvre enfant, déjà il t'aurait mis à mort et moi-même... heureusement il est en voyage et ne doit revenir que demain.
En disant ces mots, Zobéide attira Cassib auprès d'elle, appuyant sur sa poitrine, la tête charmante du poète, qu'elle baisa au front. Puis, tout à coup, elle pâlit, se prit à trembler, se leva brusquement et s'écria :
— C'en est fait! nous sommes perdus ! Le voilà qui revient plus tôt qu'il ne devait revenir ; il rapporte, sans doute, une nouvelle victime. Cache-toi là, retiens ton souffle, et attends que je vienne te chercher.
En disant ces mots, elle poussa Cassib dans un cabinet sombre, dont elle referma la porte secrète.
A travers une ouverture imperceptible pratiquée dans la boiserie, Cassib regarda curieusement. Il vit entrer un petit vieux tout cassé, qui s'appuyait sur un bâton de voyage. Sa grande barbe blanche caressait ses genoux, et sa bouche, vilainement entr'ouverte, laissait voir des dents de loup plantées en des gencives sanglantes ; il était accompagné de deux esclaves noirs qui portaient un homme, jeune encore, ligotté et suspendu à un bâton, par les pieds et les mains, ainsi que les valets de chasse portent un chevreuil abattu.
Il leur fit signe de la main, et ceux-ci s'éloignèrent avec leur fardeau, puis revinrent ensuite, les mains libres, et attendirent, silencieusement les ordres du maître.
Togrul, car c'était bien lui, s'approcha de Zobéide et lui parla durement ; chose étrange, de ce petit corps sortait, une voix formidable qui faisait, résonner les murailles métalliques du château.
— Zobéide, dit-il, avec qui donc causais-tu, quand je suis entré ; car tu ne m'attendais pas sitôt, chère bien-aimée.Il la regarda fixement, et se mit à ricaner.
— Moi, cher seigneur, je ne parlais à personne, dit Zobéide, je récitais à haute voix quelques-uns de vos vers sublimes, pour en mieux admirer les splendeurs.
Togrul, peu habitué à une pareille douceur, et singulièrement flatté, se calma, fit plusieurs tours dans la pièce, et il allait sortir, quand il aperçut le ballot d'étoffes apporté par Cassib.
— Qu'est cela? s'êcria-t-il. D'où viennent ces chiffons?
— D'un marchand qui passa tantôt, par ici et me les laissa.
— D'un marchand ! En vérité, le drôle eut de l'audace de venir jusqu'en mon palais, et toi, tu as osé le recevoir. Et on l'a fait disparaître, j'imagine ?
— Non, j'ai ordonné qu'on lui laissât la vie, et qu'il pût s'en aller en liberté.
— Ah ! Tu as ordonné ! Tu sauras qu'il n'y a que moi qui ordonne ici.
En même temps, il fit un signe aux deux esclaves, qui se saisirent de la princesse, et en un clin d'oeil, lui enchaînèrent les poignets.Cassib ne put supporter cela sans révolte, mais il songea que son intervention serait inutile, nuisible même, et qu'il valait mieux conserver son énergie, pour une meilleure occasion.
— Au cachot ! trancha simplement Togrul, et quanta ce marchand, je veux qu'on batte toute la montagne, et qu'on me le ramène pour le châtier moi-même.
Et il sortit.Cassib, voyant qu'ils étaient sur une fausse piste, se garda de bouger et résolut d'attendre le moment favorable, pour courir à la recherche de son frère, et aussi pour délivrer Zobéide. Puis, comme il était resté debout jusque-là, brisé par l'émotion, il se sentit fatigué, et chercha, à tâtons, dans l'obscurité du cabinet, s'il ne trouverait pas où s'asseoir.
Comme il palpait les murs, ses doigts se trouvèrent rencontrer une sorte de rugosité ; il y appuya, sans prendre attention, et tout à coup se sentit descendre comme par une trappe, à une vitesse vertigineuse. Au bout d'une seconde de ce voyage qui lui parut un siècle, il se trouva déposé dans une sorte de cave sans issues, portes ni fenêtres, et éclairée cependant d'une lumière éblouissante qui paraissait tomber du plafond et était enfermée dans de petites ampoules de verres multicolores.
Lorsqu'il eut bien considéré ce phénomène, il regarda autour de lui ; sur une table large et haute se trouvaient les instruments les plus baroques que l'imagination puisse inventer, depuis les cornues et les alambics, jusqu'à des machines à pistons, des pompes et des moteurs.Comme seul habitant de ce caveau, se trouvait un petit barbet noir, qui vint aussitôt lui lécher les pieds et l'accabler de caresses ; il le flatta de la main, ce pendant que le barbet, le regardait avec deux yeux profonds et humains d'où coulaient des larmes véritables. En même temps, il lui mordait le bas de sa robe en le tirant d'un côté comme pour le mener vers quelque chose : il arriva ainsi à un coin du mur devant lequel le chien jappa, et creusa, des pattes.
Cassib examina le mur, découvrit une aspérité, appuya à tout hasard et soudain, un immense placard s'ouvrit, présentant à ses yeux un horrible spectacle.
Dans ce placard était rangée une quinzaine d'hommes, ou plutôt de cadavres d'hommes, bien que leurs visages eussent encore l'expression de la vie.
Ils étaient appuyés contre la muraille du fond, accrochés à des clous, la tête pendant sur les épaules, les bras abandonnés, les jambes flasques.

Cassib recula d'horreur ; il regarda s'il ne reconnaissait, pas l'image de son frère; il ne la trouva point.A ce moment, du bruit se fit entendre : le chien jappa encore, et fort adroitement avec ses pattes, referma le placard. Cassib y resta enfermé mais, par une fissure, put de là, voir la scène qui allait se passer, et qui lui glaça les moelles.Ce fut Togrul qui entra, suivi de ses inséparables gardes-chiourme. Mais entre eux, un homme marchait.
Cassib le considéra avec attention. Il était blond, avait les cheveux longs et bouclés, la barbe abondante et frisée, les yeux très bleus agrandis par l'épouvante; mais malgré cette apparence de jeunesse, on sentait, en regardant le visage de près, que l'âge l'avait touché de sa griffe ; les yeux avaient des poches, et de fines rides s'entrecroisaient sur la peau, Cassib reconnut Sulfonal, le grand poète érotique de la ville de Kirmanchah.
Malgré sa terreur, il portait beau, la poitrine en avant, et il tenta même d'étonner Togrul, par sa faconde. Celui-ci trouvant qu'il parlait trop, leva un doigt.
Aussitôt l'un des hommes catapultes qui étaient présents, se mit en spirale, et lança sa tête à toute volée, dans le sternum de Sulfonal.
Celui-ci fit ouf ! et se tut.
Les esclaves noirs l'étendirent ensuite sur une sorte de table de dissection, puis apportèrent une machine munie de deux leviers et de deux tuyaux. On adapta le premier tuyau à la bouche de Sulfonal, on ajusta l'autre à un bocal où se trouvait un peu d'eau. Chacun des noirs s'empara d'un levier qu'ils se mirent à lever alternativement et à abaisser ensuite, comme s'ils pompaient.

Togrul suivait l'opération, concentrant toute son attention sur le bocal, où les premiers gaz vinrent barbotter dans l'eau, formant des globules tumultueux.
Il monologuait à haute voix.
— Peuh ! disait-il, me donnera-t-il ce que j'espérais de lui; je crains qu'il n'ait moins dans le ventre que je n'aurais supposé, il ne vaudra jamais le dernier cueilli ; à la bonne heure, celui-là, quel poète admirable, jeune, plein de feu, bouillant de sève...
Il ordonna de cesser la manœuvre, et les noirs laissèrent sur la table le poète vidé, pantelant, et ne respirant plus qu'à peine. Puis, sur l'ordre de Togrul, ils prirent une autre pompe dont ils placèrent avec soin un des tuyaux dans un bocal étiqueté, que le maître leur désigna du doigt, tandis qu'il mettait l'autre tuyau à sa bouche, ainsi qu'il eût fait d'un narghilé.
Au bout de quelques minutes, Togrul retira le tuyau de sa bouche, et, les yeux fixes, se mit à réciter des vers, comme machinalement, il dit alors :
« Son corps enduit de safran ressemble à un manteau à raies jaunes : sa gorge, elle la soulève par une mamelle ferme.
« Ses reins sont lisses : ses hanches sont pleines, sa peau est souple et fine : ses lèvres, semblables aux deux plumes de devant de la colombe d'Eika, montrent des gencives enduites d'un fard noir.

« Elle s'est levée et elle est apparue entre les deux pans d'un voile, comme le soleil au jour où il brille dans la constellation de Sad. »Cassib au comble de l'étonnement et de la terreur, reconnut les premières strophes du poème de son frère Mohammed, celui qu'il avait ciselé avec tant d'amour et dont il était si fier.
Plus de doute, le génie du lac ne l'avait pas trompé : Mohammed était bien ici ; mais où le trouver ?
Quand Togrul eut achevé de réciter sa tirade, il se mit à ricaner :— Voilà qui est bien, dit-il, et je suis pénétré, cette poésie est devenue la mienne.
Les noirs s'inclinèrent, et comme pour l'interroger, lui montrèrent, de la main, le corps de l'infortuné Sulfonal, qui s'agitait vaguement sur la table.
— Mettez-le au placard, fit Togrul, nous achèverons de le vider demain.
Le barbet se mit à japper. Cassib comprit que c'était pour l'avertir : il se dissimula derrière les Macchabées, tandis que les esclaves accrochaient Sulfonal.
Togrul disparut.
Cassib remarqua qu'il avait frappé le sol du pied, et il nota l'endroit, dans son esprit, en sortant de la cachette.
Il profita ensuite de ce qu'il avait vu, saisit les bocaux où était écrit :
« Poésie lyrique », « Poésie guerrière », « Poésie légère », décrocha les loques humaines et se mit en devoir de les regonfler, faisant exactement ce qu'il avait vu faire à Togrul.
Le premier qu'il remit sur pied fut Sulfonal lui-même. Puis il en fit autant pour les quinze autres et en peu de temps la cave fut pleine d'une meute de poètes hurlant des vers.
Mais Cassib s'était trompé en les insufflant, et il se trouva que le poète guerrier déclamait des « vers érotiques » tandis que le poète léger chantait des « hymnes au dieu des batailles ».
Cassib, qui pensait toujours à son frère, songea à se débarrasser de Togrul. Il se souvint alors que Zobéide lui avait dit au cours de leur conversation, que la puissance du « vieux de la Montagne », résidait en sa barbe et à tout hasard, il s'arma d'une paire de ciseaux bien affilés, qu'il trouva sur la table d'opération. Ensuite il frappa le sol du pied, à l'endroit magique, et tout à coup, se trouva transporté dans la chambre de Togrul qu'il trouva profondément endormi. Il se jeta sur lui, et avant que le misérable magicien pût reprendre ses sens, au réveil, en trois coups de ciseaux, lui abattit sa barbe, puis il creva les yeux des gardiens-catapultes venus pour l'assommer, et ceux-ci s'enfuirent, en hurlant de douleur.
Désormais maître du château, il le parcourut en tous sens, et découvrit facilement le cachot de Zobéide ; il lui enleva ses chaînes, et il allait retourner près de Togrul pour lui faire avouer ce qu'il avait fait de son frère, lorsqu'il se trouva en face de celui-ci, qu'escortait le génie du lac.
Il se jeta dans ses bras et Mohammed lui confia que le bon génie l'avait délivré de la forme de chien noir où il était enfermé.
— C'est toi qui étais le chien noir, dit Cassib ému. Ah ! j'en avais le pressentiment.
Le génie prit alors la parole et dit :
— En coupant la barbe de Togrul, tu lui as fait perdre sa puissance, et comme.il était en mon pouvoir, pour le punir de ses crimes, je viens de le changer en perroquet : cela lui apprendra à s'être servi de la langue et du génie des autres. Ce sera le juste châtiment de ce « Videur de Poètes », de n'avoir plus de langage à lui, et d'être contraint de répéter seulement les phrases qu'on lui apprendra...
En effet, au moment où Cassib s'éloignait de ces lieux maudits, avec la princesse Zobéide et Mohammed, son frère chéri, il assista à un bien singulier spectacle : sur la terrasse du château, il vit les poètes qui se battaient tous ensemble, et s'entretuaient, à propos d'une question de rejet, de césure, et de consonne d'appui sur laquelle ils ne pouvaient s'accorder : tandis que, perché sur une branche d'arbre, un cacatoès au plumage éclatant, criait, à tue-tête, d'une voix qui rappelait celle de Togrul : «Massacre ! Massacre ! !»
Cassib, dit-on, épousa Zobéide, dont le vieux père, le sultan d'Egypte, faillit mourir de joie, en revoyant la princesse, sa fille, et les deux frères ne se quittèrent plus jamais...
... Mais voici le jour, dit Shéhérazade, c'est le moment où le commandeur des croyants va reprendre le fardeau du pouvoir.— C'est juste ! dit Schariar, qui ajouta d'un air d'importance : cette histoire m'a beaucoup intéressé ; elle démontre plusieurs choses : d'abord, que les poètes sont irritables et ne s'accordent guère ; ensuite, que l'argent et la renommée viennent parfois à ceux qui ne le méritent pas ; enfin... mais le temps passe; nous reprendrons une autre fois le cours de nos réflexions philosophiques.
Et le sultan se rendit au bain, où son barbier, en lui faisant, les pieds, lui apprit que le ministère était renversé.
— Ah! ah! — fit gravement Schariar, — vous ne m'étonnez pas. Je m'y attendais : tôt ou tard, les ministères sont toujours renversés, ils paraissent même n'avoir pas d'autres raisons d'être... mais, prends garde à mon petit doigt, il est très douloureux !
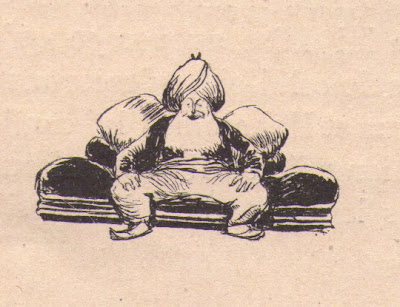
Contes des dix mille et deux nuits. Par Félix Duquesnel. Illustrations de Jean Veber. Flammarion, sans date (1904 d'après le Catalogue général de la Librairie française)
Félix Duquesnel (1832-1915), directeur de théâtre, auteur dramatique, journaliste et romancier. Dirige l'Odéon-Théâtre de l'Europe, puis le Théâtre de la Porte Saint-Martin. Collabore au Temps, au Gaulois, à Je Sais Tout, à l'Illustration...
Jean Veber sur Livrenblog : Coup de Filet par Les Veber's et compte-rendu de Willy pour Les Veber's. Les Veber : Joviale Comédie. X... Roman impromptu (à dix mains). Les Veber's par Jules Renard. Pour quelques illustrations de plus : Jean Veber par Camille Mauclair

























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire